lundi, 25 décembre 2017
Terreur sous vide : Creepy de Kiyoshi Kurosawa

Article initialement publié sur Le Comptoir
Si le Diable se cache dans les détails, le Mal, lui, se niche dans notre voisinage. C’est à travers le thème de l’horreur surgissant de la banalité que Kiyoshi Kurosawa développe l’intrigue de son dernier film : Takakura, un ancien détective devenu criminologue à l’université, emménage avec sa femme dans un quartier paisible. Alors qu’un ex-collègue lui demande d’enquêter sur la disparition inexplicable de trois membres d’une même famille, sa femme trompe l’ennui en faisant la rencontre de leur nouveau voisin, Nishino. À partir de cette situation initiale va se dérouler un jeu de piste filandreux reliant l’enquête sur les disparus, la vie privée du couple et la personnalité trouble de leur voisin. Au point de faire radicalement chavirer le quotidien le plus tranquille. Car du simple malaise peut naître le cauchemar le plus atroce, d’agréables habitations se transformer en dédales de tortures, une famille se dissoudre dans le crime comme le plastique dans l’acide.
Jonglant avec facilité d’un genre à l’autre, Kurosawa délaisse ainsi “l’inquiétante étrangeté” des fantômes (Séance, Kairo, Loft, Vers l’autre rive, etc.), pour le thriller horrifique où la psychologie des personnages se révèle d’une complexité malsaine (à l’instar notamment de Cure et Shokuzai). Au sein même du film, porté par une mise en scène plus suggestive qu’explicite, les registres s’entremêlent : du polar classique l’histoire sombre lentement dans une sorte de bouffonnerie macabre qui doit tout au personnage fou et manipulateur de Teruyuki Kagawa. Et si la fascination hypnotique qu’inspire le tueur est d’une perversité maladive, la véritable épouvante semble être celle des recoins de noirceurs logés en chacun qui nous font basculer, de nous-mêmes, dans les pièges tendus à notre image.
Sylvain Métafiot
23:48 Publié dans Cinéma | Tags : terreur sous vide, le comptoir, sylvain métafiot, kiyoshi kurosawa, creepy | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 06 décembre 2017
L’industrie de la terreur : aux origines du nazisme

Article initialement publié sur Le Comptoir
La violence génocidaire du nazisme est ancrée, depuis le XIXe siècle, dans l’histoire de l’Occident, du capitalisme industriel, du colonialisme, de l’impérialisme, de l’eugénisme, du darwinisme social et de l’essor des sciences et des techniques modernes. C’est la thèse d’Enzo Traverso, historien spécialisé dans l’histoire politique et intellectuelle du XXe siècle, qui démontre la généalogie européenne de l’entreprise exterminatrice du Troisième Reich.
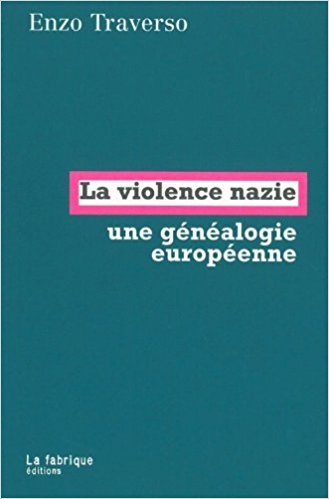 À la suite d’Hannah Arendt montrant, dans Les origines du totalitarisme, les liens qui rattachent le nazisme au racisme et à l’impérialisme du siècle des révolutions industrielles, Enzo Traverso affirme que sa particularité réside dans « la synthèse d’un ensemble de modes de pensée, de domination et d’extermination profondément inscrits dans l’histoire occidentale ». Dans La violence nazie : Une généalogie européenne, il analyse la façon dont les nazis, bien qu’haïssant profondément le libéralisme politique, se sont servis du progrès industriel et technique, du monopole de la violence étatique et de la rationalisation des pratiques de dominations, tous hérités du XIXe siècle, pour mettre en œuvre l’extermination d’une partie de l’humanité. Des historiens tels qu’Ernst Nolt, François Furet et Daniel Goldhagen ont respectivement démontré que le national-socialisme fut un mouvement contre-révolutionnaire s’opposant au bolchevisme, que le communisme et le fascisme s’opposaient au libéralisme politique, et que le génocide juif résultait d’un antisémitisme aux accents allemands prononcés. Pourtant, les origines du nazisme ne se résument pas aux anti-Lumières, à l’idéologie völkisch et à l’antisémitisme racial.
À la suite d’Hannah Arendt montrant, dans Les origines du totalitarisme, les liens qui rattachent le nazisme au racisme et à l’impérialisme du siècle des révolutions industrielles, Enzo Traverso affirme que sa particularité réside dans « la synthèse d’un ensemble de modes de pensée, de domination et d’extermination profondément inscrits dans l’histoire occidentale ». Dans La violence nazie : Une généalogie européenne, il analyse la façon dont les nazis, bien qu’haïssant profondément le libéralisme politique, se sont servis du progrès industriel et technique, du monopole de la violence étatique et de la rationalisation des pratiques de dominations, tous hérités du XIXe siècle, pour mettre en œuvre l’extermination d’une partie de l’humanité. Des historiens tels qu’Ernst Nolt, François Furet et Daniel Goldhagen ont respectivement démontré que le national-socialisme fut un mouvement contre-révolutionnaire s’opposant au bolchevisme, que le communisme et le fascisme s’opposaient au libéralisme politique, et que le génocide juif résultait d’un antisémitisme aux accents allemands prononcés. Pourtant, les origines du nazisme ne se résument pas aux anti-Lumières, à l’idéologie völkisch et à l’antisémitisme racial.
Singularité historique sans précédent car conçue comme le but ultime « d’un remodelage biologique de l’humanité » (« Les nazis avaient décidés qui devait et qui ne devait pas habiter cette planète », Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem), la machine de mort nazie fut la conséquence de l’enchâssement mécanique des quatre grands rouages de déshumanisation du monde occidental.
17:15 Publié dans Politique | Tags : la guillotine, la prison, l'administration rationnelle, l'usine, enzo traverso, hannah arendt, sylvain métafiot, le comptoir, l’industrie de la terreur, aux origines du nazisme, totalitarismes | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 22 novembre 2017
Habiter le temps et l’espace par Bernard Charbonneau

Article initialement publié sur Le Comptoir
Penseur fondamental de l’écologie politique, ami de longue date de Jacques Ellul avec lequel il s’engagea dans la mouvance personnaliste, Bernard Charbonneau décrit dans L’homme en son temps et en son lieu, comment l’accélération du temps et la concentration de l’espace mettent à mal la liberté humaine. Une critique radicale du système technicien et du développement industriel à l’époque soi-disant bénie des “Trente Glorieuses”. Enrégimenté dans la civilisation techno-industrielle, l’homme moderne, mû par une soif de vitesse, cherche inlassablement à gagner du temps, à fuir le présent, se cognant aux murs d’une société surpeuplée et dépersonnalisante dans laquelle l’espace vital réel s’amenuise dangereusement : « Dans un monde toujours plus uniforme, nous sommes condamnés à être de plus en plus superficiels. »
Alors qu’un certain nombre de ses ouvrages restent encore inédits, il faut rendre grâce aux éditions RN d’avoir exhumé ce texte, rédigé en 1960, d’une brièveté inversement proportionnelle à la densité de sa prose. À sa lecture c’est une évidence : penseur d’une rare érudition, Charbonneau n’en était pas moins poète. Son écriture est portée par un souffle lyrique venu des âges anciens. Rares sont les penseurs de cette trempe qui savent allier les références historiques, bibliques et littéraires à l’analyse sociologique complexe avec une telle aisance.
Et si certains doutent encore de la puissance imagée de sa langue, voilà de quoi balayer leur méfiance : « Qui prend son temps, en découvre dans cet arrêt le mouvement : l’individu trop pressé ne peut plus mesurer la profondeur de l’urgence. Et qui savoure l’instant sait bien que l’amertume de sa fragilité en est le sel ; il nous atteint si vivement parce que sa douleur nous blesse ; sa lumière est éblouissante parce qu’elle est celle d’un éclair. La conscience seule donne toute sa force à l’instant en nous éveillant à sa présence, mais elle nous apprend qu’il passe, et de ce mouvement il vit. Ainsi, pas plus que le Ciel ne détruit la Terre, l’Éternité ne détruit l’instant ; elle est le sang qui anime sa chair, l’esprit dont son corps frémit. »
Sylvain Métafiot
17:27 Publié dans Littérature, Politique | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, habiter le temps et l’espace, bernard charbonneau, l’homme en son temps et en son lieu, éditions rn | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 08 novembre 2017
Les âmes noires : Le Rapport de Brodeck

Dans un village isolé d’Europe de l’Est, un drame odieux s’est produit. Brodeck, le seul absent de cet “événement”, est chargé de rédiger un rapport pour raconter ce qui s’est passé. Cela aurait-il un lien avec l’arrivée de l’étranger, « der Anderer » (l’autre), artiste débraillé et lunaire, survenue quelques mois plus tôt ? Brodeck accepte, craignant pour sa vie et celle de sa famille.
Après avoir exploré la folie errante d’un marginal avec Blast, Manu Larcenet continue de creuser la veine tortueuse de l’âme humaine en adaptant le terrible récit de Philippe Claudel, s’enfonçant dans les tréfonds ignominieux de l’Histoire. Si Blast, au terme d’un voyage extravagant, dévoilait une abyssale cruauté dans le dernier tome, il ne faut que quelques pages du Rapport de Brodeck pour saisir la lourde destinée qui enveloppe ce village. Les horreurs de la guerre ont imbibé de leurs poisons la chair des habitants, générant un climat de violence délétère. Le rapport que rédige Brodeck sera pour lui l’occasion de régler ses comptes avec un passé proche qui le hante. Lui qui a subi de plein fouet la lâcheté et la trahison des “siens” : « Depuis longtemps, je fuis la foule car tout est venu d’elle… La guerre… Et les Kazerskwirs qu’elle a ouverts dans le cerveau des hommes. On peut se rassurer en disant que la faute incombe à ceux qui l’exhortent. C’est faux. La foule est un corps solide, énorme, tricoté de milliers d’autres corps conscients. Il n’y a pas de foule heureuse ni paisible. Derrière les rires et la musique, le sang chauffe et s’agite. Je les ai vus, moi, les hommes à l’œuvre, quand ils ont la certitude de ne pas être seuls… »

Le trait sombre de Larcenet épouse la parabole de la destruction de l’homme par l’homme tracée par Claudel. Le nœud qui enserre le ressentiment individuel au crime collectif est le fruit pathétique de cette crainte irrationnelle envers autrui. Reste la parole pour témoigner, l’art pour sublimer et l’exil pour renaître.
Sylvain Métafiot
16:35 Publié dans Littérature | Tags : sylvain métafiot, le comptoir, le rapport de brodeck, manu larcenet, philippe claudel, les âmes noires | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 16 octobre 2017
Le croisé des lettres : Léon Bloy Écrivain légendaire d'Emmanuel Godo

Article initialement publié sur Le Comptoir
À l’occasion du centenaire de la mort de Léon Bloy, articles, colloques, ouvrages et tables rondes fleurissent dans le paysage littéraire français. Il faut également compter sur la biographie d’Emmanuel Godo, professeur de littérature à Henri-IV : Léon Bloy Écrivain légendaire. Lui qui avait déjà consacré des essais à Barrès, Hugo, Huysmans ou Nerval, s’attaque désormais au vieux de la montagne, « le maître absolu des belluaires, des rouleaux compresseurs, des mastodontes ».
Rabroué par les journaleux de son époque, méprisé par ses confrères écrivains, moqué par les éditeurs parisiens, Bloy ne s’est jamais rendu, s’acharnant à lutter contre la bêtise de son temps avec l’obstination d’un enragé de la plume, s’abattant de toute sa masse hirsute et noire sur la médiocrité satisfaite de ses contemporains. Profondément désespéré, tirant sa force des larmes et de la douleur, Bloy ne fut pourtant jamais pessimiste : « Je n’estime que le courage sans mesure et je n’accepterai jamais d’être vaincu, – moi ! » clame-t-il dans son journal. Car chez lui « le désespoir le plus noir jouxte l’espérance la plus lumineuse » et ce frottement des extrêmes sensibilités provoque un embrasement de colère que le flot des jérémiades modernes n’a jamais pu éteindre. L’indignation de Bloy face à l’approbation du monde tel qu’il ne tourne pas rond est totale et inextinguible. Les tartuffes de l’Église lui donnent la nausée, les dévots du positivisme hérissent ses sourcils, les jaspineurs des lettres crispent ses poings. Bloy est un moine-soldat échappé des croisades, un « chrétien des Catacombes » venu rosser les ventripotents bourgeois de son siècle par l’ardeur infinie de son verbe.
Barbey d’Aurevilly ne s’y trompait pas en décrivant son enthousiasme révolté : « Vous l’avez profond, embrasé, continu, sans flammes éparses, mais plus concentré que s’il s’en allait par flammes, mais mouvant comme le feu du soleil, dans son orbe, ce fourmillement brûlant qui le fait astre, même quand il n’a pas ses rayons ! » Subissant une misère matérielle terrible, chérissant sa peine, exaltant son rejet, Bloy n’en demeure pas moins affamé d’absolu, assoiffé de justice, tirant de son dénuement le plus total sa puissance d’éloquence, plongeant au plus profond de lui-même pour en extraire un « grandiloque de boue et de flammes ». Lui qui n’écrivait que pour Dieu, se rêvant prophète ou saint, fut un écrivain malgré lui, l’intermédiaire d’une Vérité supérieure, se servant de l’art comme contrepoison à l’idéologie du désastre. Partant, « l’œuvre de Bloy, affirme Emmanuel Godo, nous parle d’un sentiment que nous ne connaissons que trop bien : de l’impérieuse nécessité de ne pas se laisser déposséder de son désespoir par une époque sans scrupule. »
Sylvain Métafiot
16:26 Publié dans Littérature | Tags : léon bloy, sylvain métafiot, le comptoir, le croisé des lettres, emmanuel godo | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 27 septembre 2017
Les “techniciens” à l’assaut de la France

Article initialement publié sur Le Comptoir
Les années 1920 ont vu l’apparition au sein du patronat, des syndicats, mais également de familles politiques, de “techniciens” tentant de proposer une réforme administrative qui s’inspirerait, en partie, de la rationalisation et des logiques de l’industrie. La “rationalisation” – à travers des mesures comme le travail à la chaîne, la standardisation des produits, l’organisation scientifique, les ententes des producteurs ou encore la réforme organisationnelle – correspond à l’optimisation maximale et calculée des ressources humaines et matérielles du pays, et donc à une domestication sociale des individus conforme à la logique de rentabilisation du système capitaliste.
Des travaux en histoire sociale montrent que la première partie du XXe siècle semble se caractériser par la substitution de la modernité – entendue comme un capitalisme dynamique qui recherche l’expansion, la productivité, la compétitivité, l’avance technologique – à la stabilité. En France, cette modernité s’accompagne d’une économie dirigée assumée par l’État qui s’est ajoutée aux forces du marché sans les supplanter. Et c’est au nom de la rationalisation de l’appareil étatique calquée sur la rationalisation du travail dans l’entreprise privée que des nouveaux réformateurs (appartenant d’ailleurs à des familles politiques très différentes) véhiculent ce projet de transformation des rapports entre l’État et l’économie. Ces fameux “techniciens” s’inspirent du privé pour transformer en profondeur le fonctionnement de l’administration de l’État, entraînant par là même une porosité entre État et économie de marché.
vendredi, 30 juin 2017
Thomas Bourdier : « La vraie subversion des auteurs réside dans leurs paradoxes »

Article initialement publié sur Le Comptoir
En créant la maison d’édition RN, Thomas Bourdier souhaitait regrouper une pléiade d’écrivains, d’essayistes, de poètes et de philosophes hors normes trop vite enterrés par le conformisme littéraire. Un travail d’exhumation des grandes œuvres oubliées du XXe siècle, permettant de remettre en pleine lumière la puissance intemporelle d’écrits aussi remarquables que ceux de Simone Weil, Pierre Drieu la Rochelle, Bernard Charbonneau, Robert Musil, Oswald Spengler, Miguel Espinosa, Ludwig Klages ou Miguel de Unamuno.
Le Comptoir : Pourquoi monter une maison d’édition aujourd’hui alors que le secteur semble plutôt moribond ?
 Thomas Bourdier : Je tiens à préciser que le critère qui a présidé à la création de RN n’était heureusement pas économique. C’était plus simplement la volonté forte d’éditer, publier et promouvoir des textes que nous aimons et des auteurs que nous admirons, comme c’est le cas, j’espère, pour tout éditeur qui se respecte. Et puis faire quelque chose qui a du sens, qui s’inscrive dans une filiation, qui n’est pas voué à disparaître en même temps que l’époque qui l’a vu naître… Soren Kierkegaard a dit qu’« on ne se lasse que du nouveau » ; un sentiment que nous partagions, en ces temps de publications hâtives et de changement perpétuel.
Thomas Bourdier : Je tiens à préciser que le critère qui a présidé à la création de RN n’était heureusement pas économique. C’était plus simplement la volonté forte d’éditer, publier et promouvoir des textes que nous aimons et des auteurs que nous admirons, comme c’est le cas, j’espère, pour tout éditeur qui se respecte. Et puis faire quelque chose qui a du sens, qui s’inscrive dans une filiation, qui n’est pas voué à disparaître en même temps que l’époque qui l’a vu naître… Soren Kierkegaard a dit qu’« on ne se lasse que du nouveau » ; un sentiment que nous partagions, en ces temps de publications hâtives et de changement perpétuel.
Concernant la santé économique du secteur, je ne pense pas que votre constat soit si fondé que ça : si l’on regarde attentivement le marché dans lequel nous nous insérons, plutôt haut-de-gamme, cela reste encourageant. Disons que ça fonctionne, assez pour tenter des choses à la fois folles et sensées. Il y a et aura toujours ce noyau de grands lecteurs auxquels nous nous adressons et auxquels s’adressent des maisons qui nous inspirent telles que Le bruit du temps d’Antoine Jaccottet, les Éditions de l’éclat de Michel Valensi, les Éditions Pierre-Guillaume de Roux, la collection de Jean-Claude Zylberstein aux Belles Lettres ou encore Allia, dont nous apprécions l’esprit entrepreneurial. Anatolia aussi, de Samuel Brussell, même si la collection n’existe plus. Si l’on ne croit pas à l’existence de ce noyau, alors on peut tourner la page de l’édition traditionnelle tout de suite…
Je crois qu’il y a surtout un renouvellement du paysage éditorial français qui est en cours, et que c’est le moment de se lancer, si l’on sait où l’on veut aller. Après la mort de grands éditeurs (Dimitrijevic, Maspéro, Pauvert, Bourgois, etc.), on a en effet assisté à une fin de cycle. Certaines maisons ont, je crois, eu du mal à gérer cette fin de cycle, à renouveler ou à mettre en valeur l’entièreté de leurs catalogues, presque trop riches, ce qui renforce d’ailleurs ma conviction qu’une maison d’édition, c’est avant tout une personnalité, plus qu’une entreprise. C’est la ligne éditoriale, l’énergie et la vision qui priment sur tout le reste. Il y a beaucoup à reprendre dans ce vivier de titres épuisés et à intégrer une ligne nouvelle où l’on trouve aussi de nombreux inédits, afin que et les uns et les autres se soutiennent et créent des constellations éditoriales originales. C’est dans ce cadre que nous souhaitons nous insérer, avec mon ami et associé William Allais. Je précise que notre envie est pré-macronienne et que nous savons que nous avons tout de même peu de chances de devenir milliardaires à travers RN…
11:12 Publié dans Littérature | Tags : thomas bourdier, rn editions, sylvain métafiot, littérature, simone weil, pierre drieu la rochelle, bernard charbonneau, robert musil, oswald spengler, miguel espinosa, ludwig klages, miguel de unamuno, le comptoir, la vraie subversion des auteurs réside dans leurs paradoxes | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 06 avril 2017
Lucas Belvaux : « L’extrême droite s’accapare et détourne les principes de la République »

Article initialement publié sur Le Comptoir
Cinéaste engagé au style sobre et incisif, Lucas Belvaux se fait le témoin de drames individuels pour mettre à nu les affres sociaux d’une société rongée par le libéralisme économique, l’inculture de masse et le repli sur soi. À l’occasion de la sortie de son nouveau film, « Chez Nous », nous nous sommes entretenus du discours identitaire français d’aujourd’hui.
Le Comptoir : Chez Nous dresse le portrait d’une jeune infirmière précaire qui se met au service d’un parti nationaliste en vue des prochaines élections. C’est la banalisation grandissante de l’extrême droite en France qui vous a motivé à raconter cette histoire ?
Lucas Belvaux : Bien sûr, en partie. J’avais envie de faire le portrait d’une candidate qui va porter et représenter le discours d’extrême droite, s’en faire le porte-étendard à son corps défendant. Je voulais raconter une histoire personnelle : comment une jeune femme est impactée par la politique dans sa vie quotidienne, dans son engagement quotidien, malgré elle, pour des raisons qui ne sont pas exclusivement politiques.
L’autre axe, c’était de faire un instantané, un portrait d’un parti populiste aujourd’hui en Europe occidentale et en France en particulier. Et cela ressemble fortement au Front national.
20:10 Publié dans Cinéma | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, extrême droite, front national, lucas belvaux, cinéma, jérôme leroy, république | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 13 février 2017
Le rire du Malin : The Strangers de Na Hong-jin

Article initialement publié sur Le Comptoir
Dans la petite ville de Gokseong d’étranges meurtres sont commis : les habitants semblent atteints d’une frénésie barbare qui les fait s’entretuer sans raison apparente. Jong-gu, officier un peu pataud, soupçonne un Japonais reclus dans la forêt d’avoir empoisonné la population au point de la rendre démente.
Fasciné par les jeux de pistes dans lesquels s’abîment les tourments humains, Na Hong-jin fait partie de cette nouvelle vague de réalisateurs (avec Kim Jee-woon, Bong Joon-ho et Park Chan-wook) qui redéfinit radicalement les contours du cinéma sud-coréen, en imposant une violence formelle que l’on croyait réservée aux productions japonaises de Takashi Miike, Shinya Tsukamoto ou Sono Sion. The Chaser, son premier long-métrage, figurait déjà une course contre la mort face à un tueur en série dans un Séoul interlope et poisseux. The Murderer, son film suivant, collait aux basques d’un travailleur pauvre pris en chasse par la mafia locale et les autorités chinoises.
The Strangers est quant à lui tout simplement magistral dans sa manière de nouer les genres (le burlesque et l’épouvante, le polar et le fantastique) : le ton oscille constamment entre la comédie bouffonne et l’horreur pure, perturbant autant les repères des spectateurs que ceux des personnages. D’où la confusion mentale de l’antihéros qui de simple flic menant sa petite enquête voit toutes ses certitudes, et notamment son rôle de père, voler en éclat sous l’effet de la confrontation au Mal. Contamination, possession, destruction : la vision apocalyptique de Na Hong-jin se décline au pluriel, accentuant l’effroi visuel d’un labyrinthe de ténèbres qui ne semble épargner personne.
Sylvain Métafiot
00:33 Publié dans Cinéma | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, le rire du malin, the strangers, na hong-jin, polar, fantastique, épouvante, burlesque, gokseong, jong-gu | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 04 février 2017
Le poignard et la grâce : The Assassin d'Hou Hsiao-hsien

Article initialement publié sur Le Comptoir
Il est des films dont la sensualité picturale est si éclatante, la virtuosité scénique si déroutante, que l’œil peine à se réadapter à la triste réalité du monde. The Assassin fait indéniablement partie de ces œuvres qui marquent la rétine d’une beauté persistante longtemps après leur visionnage. « De quel sort avons-nous été victime ? » murmure-t-on en sortant de la salle.
Ensorcelé par une magie que l’on croyait oubliée, on peut néanmoins être décontenancé par une intrigue hautement complexe : sous la dynastie chinoise des Tang du IXe siècle, Nie Yinniang, experte en art martiaux, est chargée d’assassiner son cousin Tian Ji’an, gouverneur dissident de la province militaire de Weibo. Problème : Yinniang, malgré sa fidélité à l’ordre des assassins, demeure éprise de Tian Ji’an. C’est sur cette toile de fond politique que se tisse le dilemme moral de Yinniang, contrainte de choisir entre la voie de l’épée et celle du cœur.
S’inscrivant dans la noble lignée des wu xia pian (ces films de sabre chinois dont The Blade de Tsui Hark est le plus mémorable représentant), The Assassin a la particularité de reléguer, nonobstant leur maestria, les scènes de combat en arrière-plan de sa fresque historique. Le film se focalise davantage sur les délicates relations qui nouent le destin des personnages, s’attardant sur leurs paisibles activités quotidiennes et leurs manigances obscures, accordant enfin une place centrale aux sentiments contrariés de Yinniang qui l’amèneront à défier son maître et figure maternelle, précipitant son émancipation existentielle.
D’une élégance rare, la mise en scène de Hou Hsiao-hsien se fait contemplative, accordant une attention particulière aux détails les plus infimes de ce conte médiéval : le vent dans les arbres, le bruissement des vêtements, le ruissellement de l’eau, le piaillement des oiseaux, le souffle des lames qui s’affrontent. Un souffle calme et assuré qui parcourt de bout en bout ce récit épique, le transportant sur les rives mythiques d’une splendeur filmique que l’on croyait inaccessible.
Sylvain Métafiot
15:17 Publié dans Cinéma | Tags : sylvain métafiot, le poignard et la grâce, the assassin, hou hsiao-hsien, wu xia pian, le comptoir | Lien permanent | Commentaires (0)









